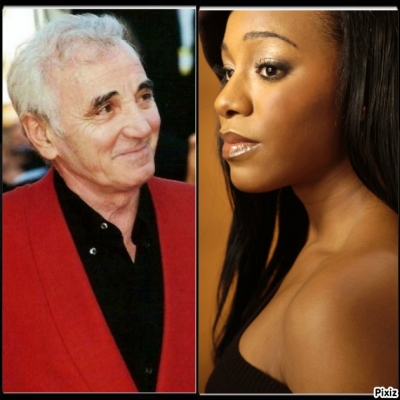TSA en Outre-mer : la grande arlésienne

A l’heure où le printemps du cinéma bat son plein, et à quelques mois du festival de Cannes, il semble important de faire le point sur la situation ubuesque du financement du cinéma en Outre-mer.
L’Octroi de mer : chronique d’une mort annoncée ?

Le 11 mars 2013, le quotidien Le Parisien présentait l’ensemble des dispositifs fiscaux imaginés par nos gouvernements et retoqués par la Commission Européenne. D’ici un an, l’octroi de mer, spécifique aux départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et Mayotte en janvier 2014), pourrait bien être intégré à cette liste. Il s’agit d’un impôt indirect qui frappe les marchandises importées ou produites localement et qui, de manière dérogatoire, porte atteinte à la libre circulation des marchandises, liberté fondamentale de l’Acte Unique Européen (AUE). C’est pourquoi en 2004 l’Union Européenne avait fait de cet impôt un dispositif fiscal en sursis : il sera maintenu, mais jusqu'au 1er juillet 2014 c'est-à-dire demain...
Du Congo aux Antilles

En 1992, le réunionnais Tonton David chante "Il est important que l’Afrique soit forte, tous pour un même but, voilà notre force". Ce chanteur engagé nous rappelle que les défaites des uns ne sont jamais que les défaites de tous !
Abandonnant les mots évidés de leur substance, comment inscrire dans le réel, comment illustrer dans la pratique, une relation "décomplexée" avec l’ Afrique? (Toutes ressemblances avec une expression déjà employée n’étant bien sûr que pure coïncidence !) .
Le développement endogène, un concept à nuancer

Depuis les importants mouvements sociaux qui ont paralysé les départements et collectivités d’Outre-mer en 2009, le concept de développement endogène est revenu chez nos politiques comme un leitmotiv. Le Président Nicolas Sarkozy en avait fait la colonne vertébrale de son programme politique pour l’Outre-mer, jusqu’à nommer en 2010 trois commissaires chargés de son application.
L'île Maurice, un modèle à suivre?

Avec son million 300 000 habitants, Maurice, petit pays indépendant à l’est de Madagascar, plateau continental émergé à 220 kilomètres de la Réunion, est un des tigres de l’Afrique Australe. La richesse produite par habitant est encore faible, le PIB par tête y est inférieur à celui de la Réunion (15 000 dollars per capita)…mais ce résultat est obtenu sans subventions extérieures et sans transferts de revenus sociaux. Maurice et la Réunion sont cousins. Comment en effet ignorer la géographie, comment séparer deux populations que les mariages et les familles rapprochent ? Il y aura toujours un lien entre ces deux jumelles, comme une communauté de destin. L’immigration, les influences indienne et chinoise cimentent la relation de deux populations consignées sur de petits territoires au sud de notre monde austral, condamnées l’une et l’autre à inventer un modèle original soluble dans la mondialisation.
Les coups de cœur de François Thomas au salon de l’agriculture

Au salon de l'agriculture, osez l'innovation
Comme à l'accoutumée, les stands Outremers du salon de l'agriculture sont nichés au fin fond du hall 7. Ils ont grimpé d’un étage par rapport à l'année passée : un grand espace au dernier étage. Les professionnels ultramarins sont hébergés sur les stands des chambres d'agriculture ou sur les stands qu'ils ont loués.
L'aquaculture en Outre-mer
Dans le Pacifique-Sud, à Wallis, Royaume d’Ouvea, les églises des villages ont leur porche orienté vers la mer. C’est de la mer que sont venus les évangélisateurs et l’espérance d’une vie meilleure…. C’est de la Mer que va venir l’espoir d’une industrialisation de l’Outre-mer français. Pourquoi?? Parce que ces morceaux épars de la République en font l’un des premiers pays maritimes géographiquement au Monde. La France, qui n’a jamais beaucoup investi dans sa puissance océanique, se retrouve avec des milliers d’hectares d’océan tropical… C'est-à-dire avec une mer suffisamment chaude pour élever du poisson toute l’année. Le froid ralentit la croissance des espèces marines. A Mayotte, un poisson grandit six fois plus vite qu’en Europe. A travers la Caraïbe, Guadeloupe et Martinique réunies, avec la Guyane, zone de frayère naturelle du Bassin amazonien, la France dispose de zones sécurisées et reconnues d’élevage de poisson dans l’Atlantique. C’est en Guyane, qu’on envisage d’installer la plus grande zone de production de poisson d’eau douce d’Europe…
La France dans le Pacifique, quelle vision pour le 21ème siècle ?

Focus sur un thème évoqué lors d’un colloque qui s’est déroulé au Sénat il a quelques semaines. Un colloque organisé par la délégation sénatoriale à l’Outre-mer, le Ministère des Affaires étrangères, et le Ministère des Outre-mer.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce colloque, qui est l’illustration de la ligne éditoriale de ce webzine puisqu’il concerne notamment les collectivités françaises, comme atout pour relever les défis du 21ème siècle notamment dans le Pacifique.
Jamais vous n’allez pouvoir vous passer de banane

La banane est originaire de Madagascar. Elle est implantée en Afrique, en Chine, et dans le Pacifique Sud au début de l’ère Chrétienne. Les arabes qui l’amènent en Méditerranée en 650 environ. Mais, il faut attendre le XVIème siècle pour que les portugais la transporte dans les « îles a sucre ». On la consomme crue, en dessert, en accompagnement de plat principal, en chips et même en vin en Afrique du Sud.
Les Outremers très présents au 50ème Salon International de l'Agriculture à Paris

Pour la 16ème année consécutive, l'ODEADOM, l'Office de Développement de l'Agriculture dans les DOM tient son stand dans ce salon grand public, très populaire, qui ouvre ses portes le 23 février. Les régions Outre-Mer seront présentes dans les pavillons 7-2 et 7-3. Comme à chaque fois sur ce salon, la production ultramarine est valorisée.
Plus...
Une légende de l’or vert, portrait d’André Dang

C’est une incroyable histoire. Une histoire de mémoire et de revanche sur le destin.
Elle commence en 1935, sur les quais du port d’Hai-Pong. Une jeune femme de trente ans, Thi-Binh, fait parti des milliers de Tonkinoises qui s’embarquent pour la Nouvelle-Calédonie, une île où la France a besoin de bras pour pallier le manque de main d’œuvre, et surtout ce que les Français appellent « l’inconstance des indigènes Kanaks ». Cette femme laisse à sa famille trois premiers enfants, pour faire parti de cette cohorte de main d’œuvre asiatique traitée comme du bétail. Sa seule identité est d’être le matricule « A649 ». Comme l’explique Anne Pitoiset, auteur d’ouvrages sur la Calédonie et correspondante pour l’Express, les Echos et l’Expansion sur ce territoire, « l’administration coloniale a mis ce système en place pour ne plus s’empêtrer dans ces noms étrangers à rallonge ».
Calédonie, la bataille du Nickel

L'industrie du nickel de la Nouvelle-Calédonie change de visage. Après un siècle de présence et de production totalement française, la construction de deux grandes usines associant des entreprises calédoniennes à trois multinationales minières Glencore-Xstrata et Vale va bouleverser la donne. Les deux nouveaux complexes industriels vont assurer le plein emploi ou presque dans leurs régions respectives, le nord et l’extrême sud du territoire. Près de 2000 emplois directs et trois fois plus au total sont créés. Face à cet argument et aux revendications kanaks, les craintes du groupe français ERAMET le producteur historique du nickel, le « Renault calédonien », n’ont pas pesé lourds.
L’espace public, otage de la colère sociale

40% de chômeurs, soit plus de 130 000 personnes sans emplois et pour les jeunes, moins d’un actif sur deux au travail (60% de chômage chez les moins de 25 ans). La Réunion est en situation d’apnée sociale. Les jeunes prennent en otage la voie publique. Ils bloquent les routes ou stationnent aux carrefours pour interpeler les élus locaux et réclamer des emplois associatifs aux maires. Faut-il leur en vouloir? Peut-on les blâmer, eux à qui les politiques ont vendu le slogan prometteur de vivre et travailler au « péi »? En réponse au désarroi de la jeunesse réunionnaise, les maires proposent des contrats courts, histoire aussi de faire retomber la pression. On augmente la dose de morphine pour empêcher le malade de crier trop fort. Et ça le calme, sans toutefois le guérir.
Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires actuellement en cours d’examen en séance publique à l’Assemblée nationale

Ce texte est en réalité un « Glass-Steagall Act » qui a vocation en 26 articles à remplir 4 grands objectifs :
-Introduire une séparation stricte entre les activités utiles au financement de l’économie (abondées par les dépôts des clients) et les activités spéculatives que la banque réalise sur les marchés financiers pour son propre compte.
-Renforcer la supervision des activités de marché des banques : améliorer la capacité des pouvoirs publics à intervenir dans la résolution des crises.
-Renforcer la stabilité financière : répondre au besoin de régulation macro-prudentielle en dotant les pouvoirs publics des moyens de prendre des mesures pour limiter le développement des risques systémiques.
-Volet protection des consommateurs : plafonner certains frais pour les populations précaires, améliorer l’accès aux services bancaires, faciliter la procédure de surendettement.
Partenaires