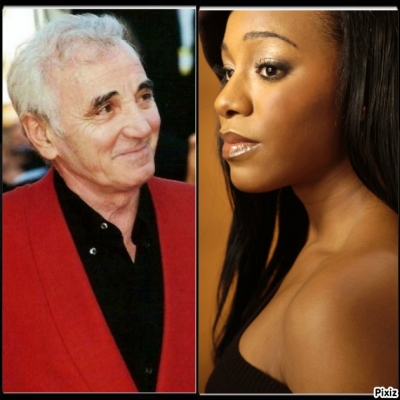Le CIRAD de Montpellier travaille sur des catalogues d’espèces comme le Tilapia, un poisson rustique, beau comme une perche, à la chair aussi bonne et fine que le bar, qui se reproduit facilement et abondamment en eau douce et en eau salée.
Un poisson énormément consommé en France dans la cuisine de collectivités ou de plats surgelés. Il manque 22 000 tonnes de tilapias chaque année en France et il est urgent d’installer une industrie quelque part…
Dans l’Océan Indien, un projet en cours d’étude veut faire de Mayotte le haut-fourneau de l’industrie aquacole, sur une production comparable à celle du saumon norvégien. Une production qui pourra être exportée partiellement vers les pays arabes, certification « Halal » et proximité religieuse obligent...
La Réunion garde tout son potentiel et surtout son marché d’un million d’habitants, même si l’investissement va beaucoup plus sur des projets de pêche que des espoirs aquacoles.
Dans le Pacifique, les filières d’exportation du poisson vers l’Europe ou le Japon, sont déjà en place : les japonais et les parisiens mangent le thon en sashimi exporté vers les centres urbains par avion, conditionné à moins 61°. Il reste à mettre en place une aquaculture répartie dans les îles de la Polynésie ou dans le lagon de Nouvelle-Calédonie qui doit penser déjà à son ère « post-nickel ».
Les polynésiens viennent d’acquérir une bonne longueur d’avance en mettant en place l’élevage du Platax, en français : la Poule d’eau. Un poisson que les tahitiens connaissent sous l’appellation de Paraha Peue. L’élevage de ce poisson a été mis au point et affiné par l’IFREMER en Polynésie, après une enquête pour savoir si les polynésiens appréciaient ou pas de poisson. Il s‘avère que le « Paraha peue » est recherché par les amateurs et les gastronomes polynésiens. Il faut un an pour produire un Paraha d’un kilo. A la sortie des cages, toute la production de 60 tonnes a été vendue en un clin d‘œil à Tahiti. Ce coup d’essai de l’IFRREMER est un véritable coup de maître. D’autres fermes de Paraha Peue sont en train de s’installer. Le cycle du poisson est maîtrisé et une structure collective fournit les alevins. La consommation locale devient le socle d’une aquaculture qui peut alors espérer grandir puisque les mécanismes d’exportation sont déjà en place : surgélation et lignes aériennes.
En France, le Professeur Jean-François Baroiller du Centre pour la Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) de Montpellier est le Pape d’une nouvelle aquaculture.
« Nous sommes à l’aube d’une ère nouvelle, raconte ce sémillant et enthousiaste quinquagénaire aux allures de mousquetaire. Nous sommes en train de mettre au point un catalogue d’espèces nouvelles à élever ».
Ces poissons se nourriront de végétaux ou de protéines végétales transformées issues d’un cycle agricole local. On pourra envisager une industrie tropicale composée d’un élément de base : le berger aquacole. La cage renferme des poissons nourris de résidus agricoles et d’algues cultivées par l’aquaculteur et les résidus aquacoles peuvent servir à élever des coquillages ou d’autres espèces marines.
Songe creux de scientifiques égarés?? Pas vraiment! Cette année l’aquaculture a fourni à la planète plus de poisson que la pêche… et ce sont les asiatiques qui tiennent la corde, s’appuyant sur des recherches scientifiques souvent faites… en France.
Justement, les scientifiques ont décidé de réagir et ont mis leurs efforts en commun : L’IFREMER, plutôt axé sur les techniques pures de production biologique s’est uni avec le CIRAD, où les sciences humaines sont mises en avant pour dessiner le système global, respectueux de la population concernée, qui doit être mis en place. Une unité de recherche mixte a été créée, l’UMR 110 Intrepid.
A Palavas-les-Flots, l’IFREMER a sa station de recherche consacrée aussi à l’Outre-mer français. Composée de cabanes et de baraquements provisoires qui feraient honte à un campement de roms, les biologistes et autres scientifiques de l’IFREMER travaillent d’arrache-pied, avec un enthousiasme communicatif. Sur un terre-plein, un biologiste surveille la croissance des algues dans un bassin à l’eau brassée. Un autre veille que son troupeau de muges, poissons omnivores, ne se nourrissent que d’algues séchées. Un dernier groupe agglutiné devant une cuve ne veut pas dire ce qu’il fait là : la recherche sur l’aquaculture du thon est stratégique et top-secrète… Car nous en sommes là : les Océans sont à bout de souffle, les surfaces de l’Indien et du Pacifique sont encombrées de détritus. La modification chimique des mers est en cours et surtout, les océans se vident à coup de surpêche de bateaux-usines… Il est clair que l’investissement financier et scientifique doit se tourner vers une aquaculture au rendement industriel et aux pratiques respectueuses de l’environnement et de la sécurité alimentaire dans l’Outre-mer français. On ne peut pas dire que les grands groupes industriels, que les grandes banques françaises se précipitent pour investir dans un secteur qui devrait grandir de façon exponentielle dans les années à venir. On ne peut pas dire que l’Etat entretienne l’enthousiasme des scientifiques et des producteurs…
Heureusement, il y a cette réalité du lendemain, ces potentialités énormes qui font que des guadeloupéens, des martiniquais comme des tahitiens ou des calédoniens sont arrivés, chacun sur leur île, à comprendre que l’aquaculture n’est plus un rêve mais bien un objectif concret. Voir les Outremers exporter leur production de poisson certifié sain, à la différence de pas mal de poissons produits dans les pays asiatiques, vers un marché métropolitain déficitaire, serait comme une réponse à des années d’assistanat et de crise économique, et l’assurance de voir des populations entières vivre de leur travail.