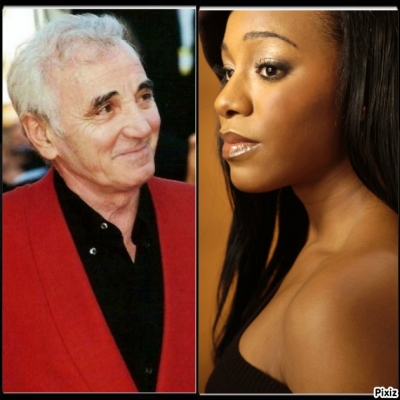Des siècles plus tard, malgré la baisse de la « ressource », sur les côtes canadiennes, et du côté de Saint Pierre et Miquelon, nous les antillais, les brésiliens, les réunionnais, nous avons conservé cet amour de la morue. A tel point que nous avons intégré « acras », « féroces », « chiquetailles », ou « rougails » de morue dans notre patrimoine gastronomique.
Mayotte, 101eme département français, à majorité musulmane, veut faire bientôt de son lagon, un vivier de poissons ayant le label Halal.
« Le lagon aux sirènes » de Mayotte va ainsi pouvoir commercialiser de manière industrielle certains poissons : ombrines, cobia, mahi-mahi... Le but est de s’attaquer non seulement aux marchés des pays du Golfe, mais aussi aux marchés européens, américains et sud africains.
Mais attention! Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs qu’avec la morue de Saint Pierre et Miquelon, en se livrant à une pêche intensive. Ce projet d’aquaculture aux ambitions pharaoniques, associe qualité alimentaire, croissance économique et dimension sociale sans abimer l’écosystème naturel.
C’est vrai qu’au cours des dernières années, il a fallu batailler ferme pour redonner vie à ce lagon qui était menacé d’extinction avec les coulées de latérite, dues à l’émergence d’un habitat mal maîtrisé.
Mayotte a surgi des tréfonds de l'Océan Indien il y a plus de 9 millions d’années. Ile ancienne par comparaison à la toute jeune île de la Réunion qui n’a que 4 millions d’années. Le lagon de cette île volcanique a une superficie de 1 557 km2. Cet écosystème fragile a des atouts incommensurables. Climat tropical maritime, échanges continuels d’eau du fait d’une amplitude de marées importante, font de ce lagon un des « hot spot » de la biodiversité marine Indo-pacifique. Il abrite des centaines d’espèces animales. C’est une véritable richesse d’une densité exceptionnelle qui se cache dans cette masse d’eau. Pour Bernard Thomassin, directeur de recherche honoraire du CNRS au centre d’océanologie de Marseille (Université de la Méditerranée), près de 35% des espèces de cétacés existant sur la planète se retrouvent dans ce lagon, qu’il s’agisse de baleines, de dauphins, ou encore de dugongs. Chaque année, la saison sèche voit revenir les baleines Mégaptères qui viennent mettre bas avant leur migration vers le grand Sud.
Comment réaliser une aquaculture de type industriel dans les eaux claires entourant l’île de Mayotte ?
Tout un pôle de recherche nécessaire à ce développement industriel a été mis au point en lien avec les autorités locales. Les mahorais sont associés à ce projet et même une université de l’aquaculture est en train de voir le jour sur l’île. Pour l’un des responsables de ce projet, il s’agit de faire de Mayotte, rien moins que le pôle européen de l’aquaculture. Une aquaculture que Jean-Jacques Robin, gérant de Mayotte aquaculture, présente comme une aquaculture durable, responsable, et créatrice d’emplois. Jean-Jacques Robin voudrait également produire sous le label Bio en s’appuyant sur un écosystème vivant et permanent. Ce label Bio, permettrait d’aller plus loin que les prescriptions édictées par la règlementation en vigueur ailleurs. Un exemple : la densité dans les cages. Elle ne devrait pas dépasser les 10kg par mètre cube, alors que les règles Bio acceptent jusqu'à 15kg par mètre cube. Juste pour avoir un point de repère, l’aquaculture traditionnelle propose un ratio de 25kg par mètre cube et l’aquaculture asiatique monte jusqu'à 60kg. Cette ferme aquacole serait entourée de filaire d’huîtres dont le principal avantage est de filtrer l’eau, de la recycler en améliorant cet écosystème totalement naturel. Le Conseil Général de Mayotte pourrait accompagner ce projet pour promouvoir un nouveau label « poisson du lagon de Mayotte ».
Toujours selon Jean Jacques Robin, la production d’ombrine (un poisson à la texture particulièrement ferme) atteignait déjà en 2010 les 120 tonnes, devrait, grâce à des technologies modernes, passer à 600 tonnes fin 2013, puis 1 000 tonnes et ensuite monter à 2 500 tonnes par an pour atteindre les 5 000 tonnes.
Plusieurs axes de vente sont prévus : les marchés nationaux, Rungis entre autres, les marchés Européens, notamment les Italiens et les Allemands. On pense aussi à la vente ciblée à des chaînes de restauration, spécialement les magasins de Sushi. La grande distribution ne serait pas oubliée, pour l’exploitation de produits transformés : filets, carpaccios, tartares. Toutes ces activités générant des emplois qualifiés.
Jean Jacques Robin conclut : « le poisson d’élevage est l’avenir des marchés mondiaux, c’est une chance unique pour l’économie Mahoraise ».
Rêve ou réalité? Ce projet fait l’objet d’études sérieuses. Il a été présenté à Bertrand Couteaux, commissaire à l’industrialisation de la zone Mayotte – la Réunion. On attend son feu vert sur la faisabilité du projet. Il servirait de modèle à toute l’industrie aquacole de l’Outre-mer.
mercredi, 27 février 2013 17:44
Mayotte, pôle Européen de l'aquaculture
Au Moyen-âge, l’Eglise catholique invitait ses fidèles à faire abstinence. Abstinence de viande, au profit de protéines provenant des œufs et surtout du poisson. C’était le début de la ruée vers Terre Neuve et Saint Pierre et Miquelon. C’était l’origine du succès de la morue, poisson des mers froides, consommée au Sud de l’Europe, puis diffusée autour du monde par « ce peuple de navigateurs catholiques que sont les portugais », comme l’écrit Jean-Robert Pitte dans Le Monde des Religions.
Publié dans
Dossier Mayotte
Partenaires

Derniers articles
Le Défi Atlantique, une transatlantique en sens inverse de La Route du Rhum
Publié le: mars 18, 2019
« Le Village préféré des Français », une belle vitrine pour Terre-de-Haut et la Guadeloupe
Publié le: février 28, 2019
Fiscalité, social, zones franches : du nouveau pour les entreprises d’outre-mer
Publié le: février 28, 2019
Les + lus
Le requin a tué, certes, mais dites la vérité aux réunionnais
Publié le: juillet 18, 2013
Y aurait-il enfin de la place pour la musique, le culturel et la créativité dans les PIB des DFA ?
Publié le: août 29, 2013
Franck Arnaud-Lusbec - l’enfant né danseur !
Publié le: février 19, 2015
Rejoignez-nous sur Facebook
Recevez les actus par email
Recevez par mail les dernières infos publiées sur OUTREMER LE MAG'
Le cheveu dans tous ses états
Catégorie: Beauté
Jessye Belleval, hommage à Aznavour
Catégorie: Evènements