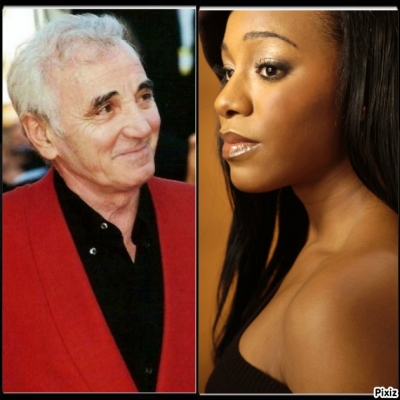Quand on lit ces propos, on pourrait croire qu’ils ont été prononcés lors de la cérémonie du 10 mai, pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage et de la traite négrière, qui cette année, a fait beaucoup de remue-ménage. Et bien non. Ces termes, qui pourraient s’inscrire dans un discours actuel, datent du XVIIIème siècle. On les retrouve dans l’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, ouvrage collectif de dix volumes dirigé par l’abbé Raynal, auquel ont collaboré de manière anonyme Diderot, d’Holbach, Jussieu, et d’autres écrivains comme Deleyre, Naigeon et Pechméja. Cet ouvrage est paru une première fois en 1770, puis en 1780.
L’abbé Raynal est un visionnaire. Ses Nouvelles Littéraires ont inspiré Grimm dans la revue Correspondance littéraire, philosophique et critique ; il publie aussi l’Histoire du Parlement d’Angleterre, et collabore à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Mais de tous ses travaux, on retiendra surtout l’Histoire des deux Indes, texte fondateur de l’esprit de tolérance, de liberté, de justice, et d’investigation rationnelle, qui retrace l’histoire de l’expansion européenne Outre-mer depuis la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb jusqu'à la déclaration d’indépendance des Etats-Unis.
Comment ce philosophe, cet homme d’Eglise, ce Rouergat, est-il devenu un pionnier de la lutte contre l’esclavage ? On trouve la réponde à Saint-Geniez, où Raynal passe la majeure partie de son enfance. Située dans la région Rhône-Alpes, cette ville a bâti une partie de sa prospérité sur la production de toile de cadis, un drap servant à l’équipement militaire. Les drapiers, qui ont des comptoirs à Livourne et à Saint-Domingue, s’y fournissent en indigo. Cet indigo, élément indispensable à la teinture bleue des uniformes militaires, est échangé contre des esclaves noirs venus d’Afrique. Très jeune, Guillaume-Thomas François Raynal apprend les rouages du commerce triangulaire entre l’Europe, l’Afrique et les îles. Son livre est un coup de pied dans la fourmilière, un coup de poignard contre les oppresseurs et les despotes, et servira la cause de Toussaint Louverture dans sa lutte de Libération des esclaves d’Haïti.
Mais Raynal ne s’arrête pas là. Si son œuvre dénonce certains aspects de la colonisation, de l’esclavagisme et de la corruption, c’est surtout un ouvrage polémique et politique qui s’attaque au pouvoir en place, au roi et aux prêtres. Ses textes invitent à accéder à la libre pensée, et c’est en cela qu’il s’inscrit parfaitement dans le mouvement de la pensée des Lumières, fondatrice de la conscience européenne et de la libre circulation des idées.
La condamnation de son ouvrage par le Parlement de Paris en 1772 a pour effet de renforcer la publicité, et, par conséquent, le succès de l’Histoire des deux Indes. L’ouvrage sera réédité, copié, contrefait, et circulera, sous la forme d’abrégé ou de brochures, dans toute l’Europe. Cet homme de réseau sait se faire entendre au-delà des frontières, et fait notamment figure de référence dans l’Indépendance américaine, mais aussi plus tard dans la Révolution française et de la Déclaration des droits de l’homme. Le jacobin Isnard déclarera que ce philosophe « semble avoir existé pour préparer les voies de la régénération actuelle ; apôtre de la liberté, il indiqua tout ce que nos représentants exécutent. Prophète politique, il décrit tout ce qui arrive ».
Le mécène ne rentre dans aucune case. Prêtre catholique, il accepte d’inhumer des protestants en les faisant passer pour des catholiques, il attaque la Monarchie, et manifeste son désaccord avec les crimes commis par les révolutionnaires. En effet, après avoir prétexté son grand âge pour décliner son siège aux Etats Généraux de 1789, il écrit, deux ans plus tard, une lettre à l’Assemblée nationale dans laquelle il dénonce les excès et les violences de la Révolution. Celui que l’on appelait « l’apôtre de la liberté » se met alors à dos les révolutionnaires, qui le font passer pour un vieillard sénile. C’est à partir de cette époque que l’auteur de plus lu de son temps est caricaturé, et tombe peu à peu dans l’oubli.
Raynal a cassé les codes de son temps et renversé les perspectives. Sa réflexion va au-delà des questions qui agitaient son époque. Elle s’ouvre sur les grands problèmes de société, comme en témoigne cette question qu’il posait en 1780 : « La découverte de l’Amérique a-t-elle été utile, ou nuisible au genre humain ? ». En 2013, le sujet est encore d’actualité. L’Assemblée nationale rend aujourd’hui hommage à la modernité de son approche de la mondialisation et de la communication, et met en lumière sa conscience de l’universalité morale de l’humanité.

« Cette soif insatiable de l’or a donné naissance au plus infâme, au plus atroce de tous les commerces, celui des esclaves. On parle de crimes contre nature, et on ne cite pas celui-là comme le plus exécrable. La plupart des nations de l’Europe s’en sont souillées, et un vif intérêt a étouffé dans le cœur, tous les sentiments qu’on doit à son semblable ».
Publié dans
Société
Partenaires

Derniers articles
Le Défi Atlantique, une transatlantique en sens inverse de La Route du Rhum
Publié le: mars 18, 2019
« Le Village préféré des Français », une belle vitrine pour Terre-de-Haut et la Guadeloupe
Publié le: février 28, 2019
Fiscalité, social, zones franches : du nouveau pour les entreprises d’outre-mer
Publié le: février 28, 2019
Les + lus
Le requin a tué, certes, mais dites la vérité aux réunionnais
Publié le: juillet 18, 2013
Y aurait-il enfin de la place pour la musique, le culturel et la créativité dans les PIB des DFA ?
Publié le: août 29, 2013
Franck Arnaud-Lusbec - l’enfant né danseur !
Publié le: février 19, 2015
Rejoignez-nous sur Facebook
Recevez les actus par email
Recevez par mail les dernières infos publiées sur OUTREMER LE MAG'
Le cheveu dans tous ses états
Catégorie: Beauté
Jessye Belleval, hommage à Aznavour
Catégorie: Evènements