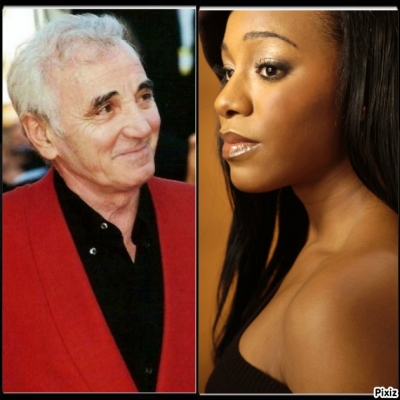Migail Montlouis-Félicité : De ton existence de conteur, de comédien et de militant, quel bilan peux-tu dresser ?
Jean-Claude Duverger : En fait je puis dire que tout est lié. Rien n’est sectorisé, rien n’est séparé. D’abord mon parcours est celui d’un enfant du quartier de Basse-Pointe, le quartier de naissance d’Aimé Césaire. C’est l’itinéraire d’un enfant qui a vu des hommes et des femmes confrontés à des difficultés se débrouiller sans se plaindre et réussir à surmonter les obstacles. Mon militantisme c’est d’abord cela, les rencontres avec ces personnes-là. De voir arriver « chez nous » ceux qui vivaient l’exode rural, venant de plusieurs lieux de la Martinique. Ils nous ont enrichis spirituellement, matériellement, culturellement. Leur savoir-faire traditionnel, les aspirations dont ils étaient porteurs, leur volonté de s’en sortir, de réussir, ne m’ont jamais quitté, m’ont sublimé, constitué. Ils nous ont transformé humainement et ont transformé « l’économie » de notre zone, son paysage géographique. J’y ai également entendu des contes, différentes manières de les dire et de vivre des veillées. Quand je suis devenu un « diseur de contes », j’ai voulu les mettre surtout au service des miens. J’ai dit ce que je voulais dire à travers ce que l’on appelle maintenant le conte contemporain ou le conte social. J’ai choisi de conter la réalité. En tant que travailleur social, je me suis aussi rapproché de la mairie pour demander d’embaucher des mères de familles en difficulté. Un beau jour la municipalité et le Parti Progressiste Martiniquais m’ont proposé de collaborer avec eux pour officier sur le terrain. Je suis donc devenu conseiller municipal, autrement dit tout ça n’est pas cloisonné : le conte, le quartier, le travailleur social, le fait d’être conseiller municipal et de militer, c’est un ensemble. Si je devais faire le bilan, je dirais que chaque jour je ne fais que recommencer. Même si je trouve du travail pour dix personnes il y en a encore d’autres qui ont besoin d’un métier. On n’est jamais satisfait pleinement de ce que l’on fait, c’est un combat permanent. Il m’est arrivé d’aider de « ma poche » et quand une personne vient me remercier ou me rembourser, je lui dis qu’il se pourrait qu’un jour Aimé Césaire ait aidé ma mère. Alors je lui demande d’épauler son prochain. Ce qui m’importe c’est que cette personne en assiste une autre et qu’ainsi s’établisse une chaine de solidarité.
M. M.-F. : Aujourd’hui, nous te retrouvons à la Gare Saint-Lazare, dans un lieu insolite où tu contribues à rendre hommage à Aimé Césaire qui des années durant a été ton ami?
J.-C. D. : Je joue plusieurs textes de Césaire, entre autres ceux du Cahier d’un Retour au Pays Natal, ceux établis à partir de certains des propos qu’il a tenus dans la vie, et ceux extraits de ses discours à l’Assemblée Nationale où il nous a souvent défendus. Nous ne sommes pas ici par hasard en train de lui rendre hommage. Cette fameuse gare Saint-Lazare où nous nous trouvons aujourd’hui était très importante pour lui. Il l’a rappelé lors d’une discussion avec Euzhan Palcy : son premier souvenir à Paris c’était à la Gare Saint-Lazare (4). Il disait : « Voir les Nègres à la Gare Saint-Lazare, mon Dieu que de Nègres que de Nègres, on pouvait y rencontrer des gens que l’on avait pas vus depuis 20 ou 30 ans». L’accostage du bateau en Martinique était un événement mais l’arrivée du train à la Gare Saint-Lazare était pour les Antillais exceptionnelle ! Lorsque nous avons avec le metteur en scène José Alpha monté cette pièce, nous avons pensé qu’il fallait la jouer ici, à la Gare Saint-Lazare. Là où ça s’est passé dans cette gare, j’ai le rôle du Nègre Pongo que Césaire aurait symboliquement rencontré, à qui il aurait raconté sa vie. Pongo est très heureux de pouvoir raconter cette rencontre avec Césaire. Il évoque pour cela le député et le poète. Il parle avec ses mots et s’adresse aux voyageurs qui déambulent sur les quais et dans les couloirs, retenant ceux qui veulent bien entendre cette histoire-là.
M. M.-F. : Césaire dont on fête le Centenaire de la naissance, fut également un homme de théâtre. Comment se porte le théâtre en Martinique ?
J.-C. D. : Je pourrais vous dire que le théâtre « bat de l’aile » parce que c’est difficile de monter des pièces. Mais il me faut ajouter que l’on y parvient aussi, avec de la volonté, et de la persévérance. Il faut être inventif. Il fut un temps où l’absence de structures, de lieux pour jouer, posait problème. La situation s’est améliorée de ce point de vue, même si maintenant rien n’est encore aisé. Le marché est court parce que la Martinique comporte 400 000 habitants avec des communes assez rapprochées et lorsque nous voulons nous exporter ailleurs le coût du transport est lourd. Nous nous déplaçons surtout pour nous faire connaître sans vraiment escompter de gains. A la Martinique quelques troupes survivent aux difficultés. Le théâtre se trouve en fait à la croisée des chemins. Il y aussi une volonté de la Collectivité qui met en place une Académie Culturelle dans le prolongement du SERMAC* avec le soutien de la Région, de Madame Yvette Galot*. Je crois de plus en plus que différentes disciplines théâtrales vont se développer. Ce qui confortera ce que le SERMAC a déjà fait pour la quasi-totalité des gens de théâtre de la Martinique.
M. M.-F. : Paradoxalement le CMAC, autre lieu culturel a perdu en 2012 son label de « Scène Nationale », mais en fait cela importe t’il de bénéficier de ce statut ?
J.-C. D. : Le label « Scène Nationale » témoigne surtout d’une relation avec l’Etat. Cela n’exclut malheureusement pas certains dysfonctionnements de temps en temps. Notamment à cause du comportement de certains des responsables de l’Etat. D’accord pour la décentralisation, mais on ne peut imposer son point de vue de manière unilatérale à une collectivité même si on participe au financement. La DRAC * d’Ile de France à cette époque-là voulait imposer son Directeur au CMAC*. Certes il y avait près de 45% du budget attribués par l’Etat, le reste incombait au Conseil Général. Mais cela n’a pas fonctionné. La DRAC s’est alors retirée et le lieu a perdu cet apport financier. Fallait-il accepter leur point de vue et se laisser « engloutir » par des cadres dont les comportements sont assez proches de ceux des gouverneurs d’antan ? Ce dont nous avons besoin c’est de travailler avec des intervenants respectant les exécutifs de nos présidents de collectivités. A cette condition, nous pourrions revenir à de bonnes relations avec l’Etat puisque notre statut départemental nous lie à lui, mais nous ne pouvons pas être systématiquement dirigés par de grands techniciens qui viennent chez nous et ne s’adaptent pas.
M. M.-F. : Le Grand Saint-Pierre est le nouveau projet social et culturel de la Région Martinique, où en est-on aujourd’hui?
J.-C. D. : Le Grand Saint-Pierre* comme l’Embellie des Trois-Ilets* sont des projets qui tiennent à cœur au Président de la Région, Serge Letchimy. Il ne faut pas oublier qu’il est un urbaniste. Il veut de plus en plus développer des zones d’activités, des zones fortes. Il a d’ailleurs mené combat pour récupérer l’Habitation Leyritz* afin d’y créer un espace culturel. Le Grand Saint-Pierre permet à des artistes de pouvoir exercer leur talent en soutenant les démarches culturelles des maires des communes à proximité. D’autres zones mériteraient d’être développées, la Martinique en a besoin et cela permettrait à la culture de devenir un important facteur économique.
M. M.-F. : En conclusion quels sont tes souhaits pour la Martinique ?
J.-C. D. : Je souhaite à la Martinique d’être lucide. J’aspire à ce que sa relation avec l’Etat repose sur une collaboration qui l’habilite à se prendre en charge et à assumer ses responsabilités dans le grand ensemble qu’est la France. Mais les décisions ne se prennent pas à 7500/8000 kilomètres. Il nous faut donc travailler ensemble, ce qui relève du possible. D’autres régions, comme l’Alsace par exemple - c’est dans l’ordre des choses- réclameront la même chose que nous. Une concentration du pouvoir n’est plus possible. Ce n’est même pas une revendication. C’est juste permettre à ceux qui sont sur le terrain de faire ce qu’ils savent faire. Comment voulez-vous par exemple qu’un Directeur de la Mer soit plus habilité qu’un Président de Région à discuter avec Sainte-Lucie ou la Dominique sur les relations de pêches dans la zone Caraïbe ? Nous devons marcher séparément mais frapper ensemble, c’est dans cette relation qu’il nous faut aboutir. Il nous faut travailler chaque fois qu’il est possible dans le respect des règles mais il faut beaucoup plus de responsabilités aux Martiniquais concernés.
* Jean-Claude Duverger dans Siméon - Film de Euzhan Palcy avec Kassav (http://youtu.be/_dJwU2htQVU
*Grand Saint-Pierre & Embellie Trois-Ilets – www.gspe3i.fr/
*Habitation Leyritz : www.bassepointe-martinique.fr/.../visite-habitation-leyritz
*SERMAC - Service Municipal d\'Action Culturelle qui depuis 30 ans forme des artistes martiniquais. -
*Yvette Galot – Conseillère régionale – responsable de la commission culture
*CMAC - Centre Martiniquais d'Action Culturelle
* Césaire – Hommage & Centenaire d’Aimé Césaire à Dakar http://youtu.be/TAxAl4uVii4
| José Alpha - fondateur du Téat Lari depuis 1983 et militant culturel. | ||
|
Pendant deux jours une équipe de tournage, les musiciens Hervé Lebongo au saxo, Christian Charles aux percussions et José Alpha ont pris d’assaut les couloirs de la Gare pour raconter la vie du poète Martiniquais depuis son arrivée dans la Capitale jusqu’à la fin de sa mandature politique à l’Assemblée Nationale en 1993. Une histoire racontée par le Nègre Pongo jouée par Jean-Claude Duverger, Pongo est un personnage qui a existé dans l’imaginaire d’Aimé Césaire. Le poète l’avait placé dans le Cahier d’un retour au Pays Natal, dans le wagon dans lequel il est assis. Assis face à lui, il l’observe, voit ses chaussures trouées, et détourne la tête « avec un sourire gêné et sa lâcheté retrouvée ». Alors moi, déclare Monsieur Alpha, je le replace sur les quais de la gare afin qu’il ramasse les déchets de l’humanité mais on le fait élégamment ». A la question posée à propos de son théâtre, José Alpha dit : « le théâtre fonctionne, avec le Téat Lari nous essayons de porter la Parole d’Aimé Césaire le plus loin possible par le prisme du théâtre de rue. L’histoire se raconte vers les populations avec simplicité mais efficacité ». |
||
|
1. Trois ouvriers agricoles trouveront la mort lors d’une grève générale sur l’Habitation Bailly au Carbet.
2. A la suite d’une grève générale sur l’Habitation Leyritz, le 6 septembre 1948 et alors que le même jour, un béké Guy de Fabrique est tué de seize coups de couteaux, seize ouvriers agricoles, soupçonnés du meurtre sont arrêtés et et maintenus en préventive durant près de trois ans. Voir à ce sujet l’excellent film documentaire de Camille Mauduech « Les 16 de Basse-Pointe ».
3. Diffusé en 2006 sur France Ô.
4. Paroles et silence d’Aimé Césaire une pièce de José Alpha.



 Il est à l’initiative du tournage du film sur Aimé Césaire qui en 1931 débarquait à Paris pour la première fois à la Gare Saint-Lazare.
Il est à l’initiative du tournage du film sur Aimé Césaire qui en 1931 débarquait à Paris pour la première fois à la Gare Saint-Lazare.