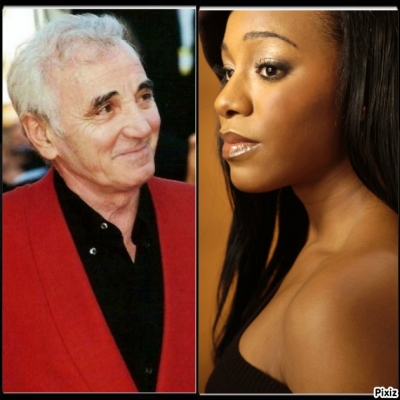En décortiquant, les résultats du référendum historique du 4 novembre 2018 sur la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, on constate que les Kanaks ont résisté à une inégalité arithmétique qui rend leur résultat encore plus glorieux.
Ils ont remporté la victoire dans 22 communes contre 12 au camp du « non » à la rupture avec la France. La différence s’est faite au niveau du nombre d’inscrits : 64 297 dans les communes gagnées par les Kanaks — toute la province nord (sauf Pouembout et Koumac), les trois communes de la province des îles et quatre villes de la province sud (Iles des pins, Sarraméa, Thio et Yaté) — contre 110 702 pour les partisans de la France, dont Nouméa, avec ses 50 686 inscrits, auxquels il faut ajouter les 45 061 de trois autres grandes villes de l’archipel (Païta, Doumbéa, Mont-Doré).
L’ESPRIT INDÉPENDANTISTE, UNE RÉALITÉ
Mathématiquement, les indépendantistes étaient défavorisés par l’évolution démographique (105 000 Kanaks représente 39 % sur une population de 269 000 habitants, selon l’Insee), qui faisait pencher la balance en faveur des populations allogènes, favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie sous tutelle française.
Par-delà ces chiffres, il faut bien admettre que l’esprit indépendantiste est une belle réalité en Kanaky, contrairement à d’autres territoires français, comme, par exemple, les Antilles.
LES ANTILLES SPECTATRICES
À la Martinique, le Mouvement indépendantiste martiniquais (MIM) reste en place, sous la houlette de son leader charismatique, Alfred Marie-Jeanne, qui a régulièrement réussi à occuper un mandat électif. Il est d’ailleurs l’actuel président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.
En revanche, en Guadeloupe la voix des indépendantistes, qui ont refusé de participer aux élections pendant longtemps, est devenue inaudible. Les positions séparatistes sont généralement défendues par les organisations syndicales, notamment l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG). Et si certaines mobilisations sociales peuvent encore drainer des foules, on ne peut pas en dire autant des rassemblements autour de l’idée d’une rupture des liens avec la France. D’ailleurs, même le Parti communiste guadeloupéen (PCG), jadis défenseur acharné de cette position, a mis de l’eau dans son vin et parle davantage d’une Guadeloupe autonome associée à la France.
UNE PROPRIÉTÉ DES KANAKS
Ces différences de niveau de conscience en matière de souveraineté peuvent trouver une explication dans le sentiment d’appartenance des Kanaks, à ce pays pour lequel ils revendiquent un droit de propriété. Peuple d’origine de la Nouvelle-Calédonie, ils n’y ont pas été amenés, comme aux Antilles, qui ont été peuplées par des groupes ethniques venus volontairement ou non d’Europe, d’Afrique, de l’Inde, du Moyen-Orient, de l’Asie, après l’extermination du véritable peuple des Antilles, les Caraïbes.
Les Kanaks, eux, ont assisté à l’arrivée massive de populations (Français, Wallisiens et Futuniens, Polynésiens, Asiatiques, etc.) venues de l’extérieur.
PAYS À DECOLONISER
Autre élément à prendre en compte : la Kanaky est inscrite par l’ONU, sur la liste des pays à décoloniser. Ce n’est pas le cas des Antilles. L’accord de Nouméa 1998 met en place les conditions d’accès à l’indépendance de ce pays. Cependant, force est de constater que les moyens pour y parvenir ne sont pas favorables aux Kanaks. Et si à l’issue du prochain référendum (en 2020 au plus tard), puis du troisième, si besoin, le résultat est toujours en faveur de la France, les prochains gouvernements et les grands leaders de la politiques française pourront toujours clamer : « Voyez-vous, nous leur avons proposé trois fois de prendre leur indépendance, ils n’ont pas voulu… ».
ENVAHIS EN 1853 SANS CONSENTEMENT
Pourtant, la logique aurait voulu qu’ils mettent en place immédiatement un processus d’accompagnement du pays à sa souveraineté, sans passer par un vote tronqué par les déséquilibres démographiques. Quand la France a envahi ce pays en 1853, elle n’a pas demandé l’avis des populations, n’est-ce pas ? La rencontre programmée en décembre, par le Premier ministre de la France, Edouard Philippe, entre les forces vives, ne devraient-elles pas se pencher sur cette réflexion afin d’éviter que le pays ne reste engluée durant les deux, voire quatre prochaines années dans l’attente d’un hypothétique « oui » au retour d’un statut originel qui a été usurpé.
DES RAISONS OBJECTIVES DE PARTIR
Compte tenu de tous ces éléments — le volet historique qui présente le « Pays des droits l’Homme» comme un envahisseur ; l’évolution démographique favorisée par la politique des différents gouvernements français ; le résultat obtenu par les indépendantistes qui montre qu’ils ne lâcheront jamais l’affaire même après un troisième référendum défavorable ; mais aussi des us et coutumes du peuple kanak, aux antipodes de la culture française ; et des 16 740 kilomètres qui éloignent Paris de Nouméa —, la France devrait partir de la Kanaky. Elle en sortirait grandie.