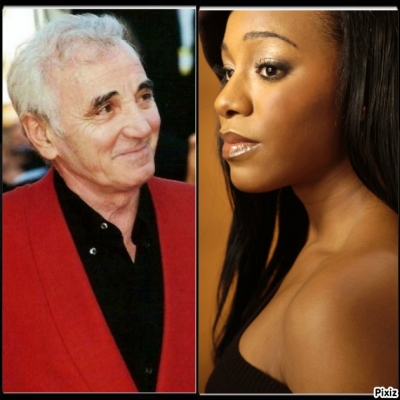Acteur volontaire de sa propre éducation sentimentale, Carl n’en continue pas moins sa quête, qui se révèlera amoureuse lors de la correspondance qu’il entretient avec une mystérieuse jeune fille en danger, la bien nommée Cœur qui Saigne… S’écrire est une chose, se rencontrer en est une autre. Le jeune homme désireux de plaire, déçoit la Belle. Leur premier rendez-vous tourne au désastre sur fond de malentendu. Les deux jeunes gens ne se reverront que des années plus tard, au cours desquelles notre héros ne pensera qu’à la soustraire au funeste destin qui l’attend.
C’est à ce moment de l’histoire que le roman prend un tour épique. Désireux de rattraper le temps perdu, Carl et Cœur qui Saigne, égarés au paradis de l’enfer d’Haïti, portés par une frénésie sans pareille, remettent leur passion à l’endroit, alors qu’autour d’eux, le régime militaire de Papa Doc sévit avec la plus extrême violence. La mort frappe à tous les coins, sourde aux humbles, aux pauvres, comme aux biens-nés, désignés gênants par le pouvoir. Victimes aussi parfois de l’humeur du moment des tontons-macoutes, affidés tout-puissants des Duvalier.
Ecrire et encore écrire, afin de pouvoir en rendre compte sans faillir à sa « maudite éducation » ? une vocation accomplie sous le sceau de l’expression d’une irréductible liberté de pensée ? telle sera la voie droite de Carl qui en fera la salutaire découverte, avec un appétit jubilatoire, après quelques essais tâtonnants.
Gary Victor, dans ce roman faustien à de nombreux égards, ne jette pas sa part aux chiens. Car c’est bien une partie de sa jeunesse qu’il nous y raconte. Celle de la naissance d’un écrivain dont les débuts furent favorisés par ses parents, au-delà de l’ébouriffante initiation que lui prodigue Gaston Paisible, un entreprenant poète. Il nous y confie aussi son irréductible insurrection personnelle contre le poids du malheur engendré par les différentes dictatures duvaliennes, responsables de tant d’injustices, d’assassinats et d’incongruités. La mort absurde de son père, à même le sol d’un hôpital, faute de soins, de par l’inexistence d’un service des urgences, à trois cent trente-trois mètres du bureau du président de la République, n’en étant pas l’une des moindres.
Avec ce livre foisonnant et plein d’humour, empreint d’Haïti à toutes les pages, c’est-à-dire universel de par sa portée historique, sociologique, métaphysique, et la justesse des flux de conscience de ses personnages, Gary Victor aborde aux rives d’un genre particulier, celui du roman d’un fils à ses père et mère que l’on sent présents derrière les mots. Un livre d’hommage aux siens : sa famille, le peuple haïtien soumis au pire et ses lecteurs qu’on souhaiterait innombrables.
Journaliste, dramaturge, écrivain, Gary Victor est déjà l'auteur d'une oeuvre littéraire majeure. Son regard aigu sur l’histoire et la société de son île natale le désigne comme l’un des plus importants écrivains de ces dernières décennies. Il a publié une quinzaine d'ouvrages dont A l'angle des rues parallèles (prix du Livre insulaire, 2003), Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin (prix RFO, 2004), Banal oubli (2008), et Le Sang et la Mer (prix Casa de las Americas, 2012).
On ne prête qu’aux riches et des gages de sa « maudite éducation » Gary Victor ne cesse de nous en faire cadeau ouvrage après ouvrage, bâtissant une œuvre dont l’ampleur s’annonce sans pareille.
Christian Séranot
Lire Maudite éducation pourquoi ?
-Parce que Gary Victor y montre le jeune homme qu’il fut, en « quête désespérée de sa fréquence », désireux de partager avec ses lecteurs une douleur qui vient de sa quête difficile d’amour et de vérité.
-Mais aussi pour les portraits saisissants qu’il dresse de ses parents à qui il doit son amour des livres. Sa mère, qu’il qualifie de « lectrice extraordinaire » et son père, instituteur puis sociologue, qui a beaucoup écrit dans des journaux spécialisés, à la bibliothèque duquel il doit tant. Sans oublier son frère Jacques, son premier lecteur aujourd’hui.
-Egalement pour son style et la composition de son roman. Si l’on en tourne si facilement les pages, il n’est pas indifférent de savoir que si son père homme plutôt austère, ne lisait que des romans dits très « sérieux », qui l’influencèrent plus tard, sa mère l’influença beaucoup, très jeune, par son penchant pour des romans étiquetés populaires. Il partagea très vite son goût pour Paul Féval, Victor Hugo (notamment celui de Notre-Dame de Paris) Alexandre Dumas et les grands romanciers anglo-saxons notamment.
-Enfin parce que nous tenons Gary Victor, que nous avons la chance de connaître et de suivre l’œuvre en lecteur privilégié depuis bientôt deux décennies ? Gary cet « homme aux mille feuilles », à l’imagination débordante, cet « homme-livres » ainsi que nous le surnommons affectueusement ? pour un écrivain majuscule, un authentique « raconteur » d’histoires, dont la fantaisie, le sens de l’humour et de la démesure ne sont pas les moindres des qualités.
Extraits choisis
Exergue
« Mon aube est encore trempée d’encre
Mes blessures tapissent la vase raclée par l’encre de mes souvenirs
L’or de mes rêves gît dans les abysses
Cousue la ville des rictus pervers des déments
La nuit tresse des brumes de lune à l’aurore de mes randonnées
La chute des âmes dans le rôle des sexes travestis
Le silence du tombeau a la sensualité infâme de ton absence.
Je m’accroche aux fumées noires de la folie qui virevolte dans les rues
Ma déraison pendue à l’incandescence de mes souvenirs. » (P.9.)
« Quand je plonge dans ma mémoire, pour remonter le cours du temps, j’atteins une frontière où il ne m’est plus possible de savoir si les images que je saisis sont celles d’une réalité disparue ou celles d’un rêve d’un temps lointain ou proche. » (P. 126)
« Mon père n’a jamais été un lecteur de fiction, cela, je l’ai déjà dit. Sa connaissance directe de la littérature haïtienne s’arrêtait à Gouverneur de la Rosée, de Jacques Roumain. Après, comme certains lettrés, il pouvait citer par cœur des vers de Roussan Camille, d’Etzer Vilaire, de Davertige ou d’Oswald Durand. Il connaissait l’ouvre de quelques romanciers sans les avoir lus, pour avoir consulté des livres de littérature, des articles critiques nombreux dans les journaux et les revues d’alors, et par les discussions qui enflamment les esprits dans les cercles littéraires dont la plupart avaient disparus, balayés par la paranoïa du dictateur. Il avait une haute opinion de Jacques Stephen Alexis parce qu’il l’avait personnellement connu, qu’il avait lu quelques passages de ses romans et qu’il avait été publié dans une grande maison d’édition française. Une reconnaissance parisienne n’était pas nécessaire pour que les écrivains, chez nous, soient connus et appréciés, mais cela, certainement, ajoutait quelque chose à leur aura. » (P. 129 et 130)
« Contrairement au rite des étreintes rapides, elle m’embrassa avec une ferveur troublante, se mettant à explorer mon jeune corps jusqu’à ce que mon excitation à son paroxysme réclame son assouvissement dans la chaleur de son sexe. Dans notre frénétique étreinte, nous quittâmes les haillons de la couche pour rouler dans la poussière de la lande. Je connus un orgasme intense, et je crois qu’elle aussi jouit comme je n’avais jamais vu une femme le faire, habitué que j’étais à étreindre seulement des professionnelles pressées d’expédier leur client. Mais aussitôt après, elle me repoussa avec brutalité, se releva, puis partit sans me réclamer l’argent… » (P. 135)
« J’acceptais l’invitation de Jean-Christophe sous réserve que ma mère approuva ma décision. Ce n’était pas que je me trouvais sous sa coupe, ainsi que certains le prétendaient. J’appréciais ses avis et j’avais plusieurs fois vérifié qu’elle comprenait très bien certaines subtilités de notre société. » (P. 175)
« Il fallait que j’admette aussi une autre vérité. J’avais fui à cause de ma chaude-pisse. Je me sentais mal dans ma peau, d’autant plus sale que j’étais confronté à la beauté, à la délicatesse et à la pureté de Cœur qui Saigne. » (P. 212)