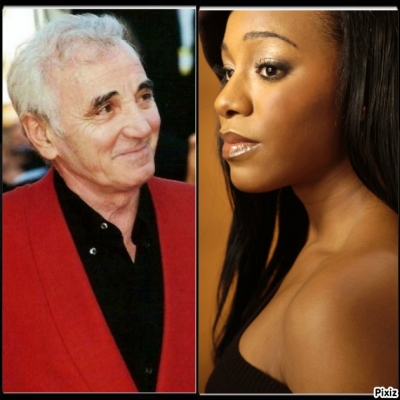Le rapport fait un point très précis sur le statut européen des régions ultrapériphériques et l’évolution du cadre juridique qui fonde la reconnaissance de leurs spécificités.? Il analyse comment l’article 349 du traité de Lisbonne concernant les RUP est appliqué, et quelles propositions peuvent être faites pour améliorer la stratégie européenne. Une stratégie révisée régulièrement dont les préoccupations premières ont été d’aider ces régions à leur développement. Aujourd’hui, elles ne sont plus « les pauvres » de l’Europe élargie ; des comptes commencent à leur être demandés sur leur compétitivité, d’autant que leur environnement régional à changé et que les pays en développement d’hier sont les émergents d’aujourd’hui.
« Il nous faut sortir de l'économie de guichet. Mise à part Saint-Martin ou Mayotte, nous en avons fini avec la politique de l'équipement, il nous faut une politique de projet sur la base d'une stratégie de développement avec un POSEI multi filières » affirme le député. Les territoires ultramarins ne peuvent se contenter des standards européens et doivent réfléchir à un POSEI multi filières qui valorise mieux les accords et spécificités régionales. (Rappelons que les DOM bénéficient d’un programme spécifique européen, le Programme d’Options Spécifiques à l’Eloignement et à l’Insularité des Départements français d’Outre-Mer (POSEIDOM), mis en oeuvre depuis 1991.Ce programme regroupe des mesures permettant de favoriser les productions agricoles locales).
Serge Letchimy relève une première difficulté : les RUP ne sont pas considérées par le Traité européen dans leur spécificités. Elles appartiennent à un groupe défini par leur différence d’avec le territoire européen. Elles ont en commun ce que leur reconnaît le Traité : l’insularité, l’éloignement, un petit territoire et une forte densité de population, et l’étroitesse de leur marché domestique.
Mais en réalité, hors des textes, les RUP sont différentes.
Quoi de commun entre la Guyane et les Açores, entre Mayotte et Saint Barth !
Le député a donc tenté, avec 43 propositions concrètes, de renforcer des politiques sectorielles, aussi bien dans le domaine agricole, celui de la pêche que celui du tourisme ou du traitement des déchets. Il propose également une nouvelle méthode de traitement des dossiers relatifs aux filières d’avenir. Propose d’une manière générale d’écarter les politiques d’amalgames entre Europe et RUP, et de renforcer certaines politiques régionales. En résumé de regarder le réel au détriment du juridique et de l’abstrait.
D’abord un même constat : alors que le PIB augmente, la courbe du chômage ne s’inverse pas. La modernisation des pays ne profite donc pas à la cohésion sociale. Localement, les importations augmentent, preuve d’une production alimentaire de base insuffisante, et la politique des aides européennes n’y est pas étrangère.
Dans le secteur agricole, les aides profitent aux productions limitées que sont la canne et la banane. En Martinique par exemple, moins de 25% des agriculteurs en bénéficient, et 45% de ceux-ci sont dans la banane. Page 41 du rapport, le député demande que soit prise en compte la filière de diversification de la production agricole, d’étendre l’éligibilité des aides aux fruits et légumes locaux ou aux produits régionaux de type label pays : ilang ilang à Mayotte, café, cacao, sucre, vanille. Certaines propositions comme la prorogation du régime fiscal applicable à la filière canne-rhum-sucre, risquent d’être difficilement recevable actuellement par l’Europe en phase sobre !
Le rapport revient aussi sur le fait que de nombreux textes adoptés par l’Europe sont parfois divergents des intérêts des RUP. Les normes européennes doivent être mieux adaptées aux marchés régionaux. La question est complexe : les normes européennes plus sévères en matière d’agriculture et de pêche pénalisent les départements en regard de leurs voisins.
Pour la pêche, la démonstration est faite : il n’existe aucune comparaison possible entre les flottilles artisanales de Martinique, Guadeloupe et celle des ports bretons. Les mêmes règles ne peuvent s’appliquer, car ce qui est possible au sein des mers européennes , crée « une concurrence inégale et déloyale avec les pays périphériques, qui est aggravée par des accords négociés sans consultation des autorités locales. Les licences communautaires sont gérées depuis Bruxelles et Paris de façon totalement déconnectée des réalités de terrain ».
Un dossier que nos voisins portugais et espagnols ont beaucoup mieux géré que la France pour leur RUP concernée!
Il est intéressant de remarquer que les propositions faites par le rapport, ne considèrent pas les exigences écologiques posées par l’Europe, comme des outils de distorsion de concurrence. Les mentalités ont évolué. Dans son approche de la filière bois par exemple, Serge Letchimy ne remet pas en question la certification des bois. Mais il serait intéressant de savoir si cette certification a permis l’exercice de la préférence européenne à l’exportation comme on l’avait promis aux exploitants ? Quant à la proposition de soutien au développement de l’agroforesterie, elle est très intéressante puisqu’elle reconnaît la capacité à la Guyane de retrouver sa vocation fruitière sans introduction d’intrants. Espérons que ce rapport ne restera pas dans les tiroirs.
photo : Pierre Chabaud/Matignon