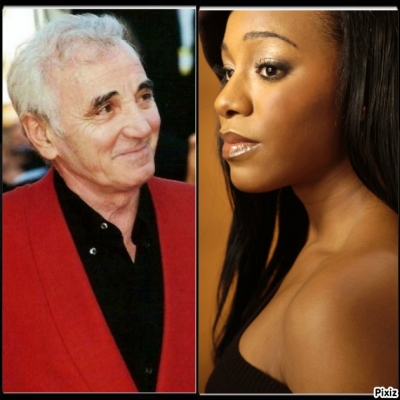A 10h le 8 mai sur la plage des Brisants de Saint Gilles le drapeau rouge « attention aux requins » avait été hissé face au trouble des eaux. Désormais, on sait que la turbidité de l'eau est un facteur de danger. Tout surfeur averti le sait. 78% des attaques à La Réunion se sont déroulées en eau trouble. Plus la visibilité est faible, plus le risque de confusion alimentaire pour l’animal est important.
A 12h20, un cri horrible signalait l’accident. Malgré le drapeau, Stéphane avait pris la mer. Stéphane, 35 ans, est la dernière victime, la quatrième en deux ans sur 23 accidents recensés. C’est moins qu’à Hawaï, mais plus qu’en Australie.
Il ne s’agit pas de désigner des responsables. Tous le sont : le surfeur victime, les autorités, le requin et la mer, le tourisme de l’extrême.

Nous avons comparé le requin et l’avalanche. Comme les skieurs, les surfeurs de l’extrême aiment flirter avec le risque. Le drapeau rouge qui alerte du danger, était hissé, mais ce n’est pas une interdiction, juste une information. Certains le regrettent. L’accident aurait-il été évité ? La loi est ainsi faite qu’elle reconnaît encore - dieu merci - des droits à chacun, dont celui de se baigner quand bon lui semble à ses risques et périls. Mais la liberté s’accompagne de devoirs pas toujours appréhendés. Comme celui par exemple de ne pas se lancer de défi individuel qui se retournerait en cas de drame contre le collectif, flétrissant l’image d’une île dont le tourisme est une activité importante. Devoir également de respecter le travail des scientifiques, chercheurs qui ont conduit à des législations de mise en protection d’un espace merveilleux et protégés de 35km2, induisant lui aussi une économie touristique éprise de beauté. Une fois les squales décimés, le biotope sera tellement déséquilibré que l’on pourra alors reparler d’enjeux économiques !
Le débat n’est donc pas seulement entre surfeurs avisés et touristes non initiés ou imprudents. Il relève d’un choix politique.
La ferme aquacole construite à Saint Leu il y a maintenant des années, avant l’essor des sports nautiques, attire indubitablement les squales les plus dangereux à proximité des plages. On ne peut pas nier que la création du parc marin a également une influence. Si l'on y ajoute le dispositif de concentration de poissons (DCP) installé au large pour recréer une chaîne alimentaire dont ils sont le dernier maillon, et la présence à proximité d'une ferme de tortues dont ils sont friands, la côte ouest de la Réunion a tout pour attirer les requins.
La réserve marine est elle compatible avec une zone d'activités balnéaires et nautiques. ?
Il appartient aux pouvoirs publics "de faire un choix". Lundi 13 Mai, Thierry Robert (député modem de Saint Leu) a fait son choix. Il a décidé d’autoriser la chasse aux requins bouledogues jusqu’à 300m au large des eaux de sa commune. Non seulement il fait prendre des risques aux chasseurs, mais il n’attend pas le résultat des mesures prises par le préfet qui préconisent le renforcement de prélèvement de requins par la pose de palangres fixes : Cameras, hameçons à calamars, l’armada est de sortie pour traquer le redoutable requin bouledogue. Une technique utilisée en Australie et en Afrique, vivement critiquée par les écologistes, pour lesquels cette méthode attire les requins, à cause de l'appât, vers les zones de baignade qu’elle est supposée protéger.
Selon Patrice Héraud, un des spécialistes français du requin, « on sait pertinemment que « le prélèvement » ça ne fonctionne pas. Trois, quatre ou même dix requins en moins, ça fait plaisir au peuple, mais ça ne règle rien, on ne va pas supprimer tous les requins de l'océan Indien….La solution, à terme, tient d'abord à la responsabilisation des gens. A travers des campagnes d'information, on leur fera mieux connaître l'animal, et donc prendre moins de risques.Mais il faut aussi déshabituer les requins au secteur, faire en sorte qu'ils ne se sédentarisent pas. Et pour ça, faire comme dans d'autres pays après une attaque de requin : interdire toute activité humaine dans l'eau. Même la pêche, dont les appâts aussi attirent les requins. Et je ne parle pas des mauvaises habitudes de rejet dans l'eau des déchets de bord ou des carcasses d'animaux morts… »
Les équilibres ont été brisés. Les lois de papier sont insuffisantes.
On sait que 61% des attaques ont lieu à proximité d'une embouchure, d'un port, d'une décharge publique. Certaines espèces de requins très dangereuses (requin bouledogue, requin tigre) fréquentent tout particulièrement les estuaires et les eaux sales ou ils peuvent se nourrir de charognes de toutes sortes.
Ce week-end, les associations Sea Sheperd*, l’AFSAS et Equinoxe 181 ont écrit au préfet « Si l’on peut faire état, à notre connaissance, d’une anomalie; c’est celle de l’absence de requins de récifs (compétiteurs des requins bouledogue) sur cette côte Ouest alors que les requins côtiers sont bien représentés. La responsabilité de cette absence de requins de récifs ne saurait raisonnablement être imputée aux autres espèces de requins. Les représentants du Conseil scientifique de la réserve Marine de la Réunion mais aussi tous les observateurs avertis de ce récif vous confirmeront que ces requins de récifs ont disparu du littoral Ouest aux cours des années 1970 à 90. Ils ont disparu car les activités humaines de pêche et de chasse sur leurs proies et sur leurs propres populations les ont décimés, avec en facteur aggravant, la dégradation massive de leur niche écologique (le récif frangeant de l’ouest réunionnais) du fait des pollutions d’origine humaine. »
http://www.seashepherd.fr/news-and-media/news-20130515-01-fr.html

Aujourd’hui, afin d’éviter une surmortalité dans les coulées d’avalanche des solutions s’élaborent peu à peu : meilleure information, sensibilisation, interdiction de partir pour ceux qui ne sont pas initiés, cours et formation, préparation du terrain par les experts de la montagne, équipement d’un matériel de survie, responsabilité financière dissuasive… Et un skieur de l’extrême voit le jour, plus responsable de lui même et de la collectivité. Les medias ont appris également que la nature ne se commande pas. Beaucoup reste à faire en ce sens sur la mer et les côtes de l’île de rêve..
|
Témoignage d’Yves Paccalet, journaliste philosophe et ancien membre de l’équipe de JYCousteau |