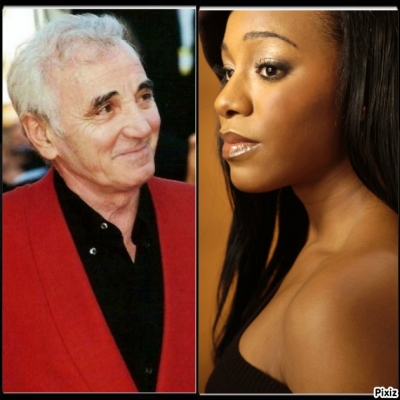Les enjeux économiques
La région vit une crise grave. Le secteur emploie plus d’un million et demi de personnes, et fait indirectement vivre des centaines de milliers d’autres. Pour le Honduras et le Nicaragua, le café constitue le premier revenu à l’exportation. En 2011-2012, l’exportation de 17,5 millions de sacs a permis à l’Amérique centrale d’engranger 3,6 milliards de dollars. Et le Brésil, qui n’est pas atteint pour l’instant par le champignon, présente une production pléthorique.
Cette manne a empêché la spéculation sur la rareté, les cours du marché sont restés bas et n’ont pas encouragé les producteurs à prendre des mesures préventives pour lutter contre la rouille. Les pays touchés trouvent difficilement de l’aide.? En cause, le climat, une mauvaise gestion des parcelles et l’adaptation du pathogène aux nouvelles espèces.
La rouille orangée est bien connue des agronomes. Causée par un champignon, nommé « Hemileia vastatrix », elle avait dévasté la caféiculture de Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka) en 1869. En 1976, le champignon est responsable d’épidémies sévères au Costa Rica, au Nicaragua et en Colombie. La maladie est un fléau, car elle est contagieuse. Le champignon est transporté sur les spores par le vent. En 2012, son développement a été favorisé par la chaleur et par l'absence de pluie. L’année 2012 a été une année « del Niño », perturbation climatique liée à un réchauffement de l’océan Pacifique, qui se caractérise principalement par une moindre pluviométrie qui n’a pas permis le lessivage des spores mais a été suffisante pour assurer leur germination. La chaleur a favorisé les attaques dans les zones d’altitude où les producteurs n’appliquent généralement pas de traitement préventif.
L’épidémie est aussi le fait de l’appauvrissement génétique des plantations. Les fermiers, en parcelle ou sous serre, utilisent un matériel génétique très pauvre. ?Or, les plants sauvages d’arabica possèdent une « formidable diversité génétique » qui pourrait être utilisée pour l’amélioration des arbres dans l’avenir. Malheureusement, selon une étude britannique alarmiste conduite par les chercheurs de la Royal Botanic Gardens de Kew (Royaume-Uni), et publiée dans la revue américaine Plos One, le réchauffement climatique menace l’arabica à l’état sauvage. Il faut faire vite.
Les solutions
Côté recherche, on se soucie d’abord du court et moyen terme.? L’objectif : arracher les plants contaminés, fertiliser, replanter des arbres sains et acheter des graines résistantes à la rouille. Un coût estimé par la filière à 300 millions de dollars.? Les chercheurs du CIRAD proposent la grosse artillerie : « À court terme, il faut reprendre les traitements phytosanitaires qui ont été négligés », notamment certains fongicides préventifs, explique Jacques Avelino, chercheur au CIRAD. « À moyen et long terme, il faudra renouveler le parc caféier vieillissant et sensible avec les variétés résistantes, et pour cela, conseille l’utilisation des hybrides ». Et trouver des souches résistantes !? Depuis 1991, les pays d’Amérique centrale et de la Caraïbe, unis au sein du réseau de recherche Promecafé, en coopération avec le CIRAD, l’Ird, le ministère français des affaires étrangères et le Catie, financent le projet de création de variétés mieux adaptées à la caféiculture régionale que les variétés traditionnelles. La diffusion massive des meilleurs candidats peut se faire par embryogenèse somatique, en utilisant le bioréacteur RITA® pour une multiplication à grande échelle. ?Il faudrait cependant être attentif à ne pas se tourner vers une solution qui uniformise et fragilise encore les plantations?. La solution n’est pas seulement le recours aux hybrides.? Un retour à une agriculture plus raisonnée est nécessaire.? Les caféiers sont fragilisés on l’a vu, par le climat et le manque de diversité génétique mais aussi par une intensification trop forte de la culture. Trop de fruits, pas assez de feuilles : le caféier devient fragile.

L’extension incontrôlée des arbustes a accéléré l’invasion. L’arbre a besoin d’ombre. Le CIRAD l’a démontré, l’ombrage permet de diminuer les attaques de rouille, par son action régulatrice de la charge fruitière. ?Collecter les espèces sauvages avant qu’elles ne disparaissent, créer des vergers et des collections, et enfin, produire un matériel végétal durablement résistant demeurent des axes de recherches importants. « Il est encore possible d’améliorer la résistance des matériels cultivés. Toutefois, les ressources génétiques que l’on peut utiliser dans l’amélioration végétale ne sont pas inépuisables, et il ne faut pas sous-estimer la capacité d’évolution des pathogènes », conclut Jacques Avelino. C’est pourquoi dans les collections végétales de Guyane, le CIRAD veille avec beaucoup de soin sur son parc de caféiers.

Les collections du CIRAD à Combi forêt (commune de Sunnamary) Photos Y. Lagoyer
|
Les collections du CIRAD en Guyane et en Guadeloupe pourraient être bien utiles
arabusta... Les premiers proviennent des montagnes d’Ethiopie, les seconds du bassin du Congo, les troisièmes, issus de leur croisement, combinent l’arôme des premiers à la vigueur des seconds ». L’ingénieur tente de développer ici son projet de cafés AOC Guyane. ?Le CIRAD, l’Inra et l’IRD se sont associés, au sein d’Inter-TROP, le réseau des Centres de ressources biologiques (CRB) de Plantes tropicales, aux Antilles, en Guyane, à la Réunion et à Montpellier. Son rôle se résume en deux points : conserver les collections constituées depuis des décennies par les organismes de recherche, et fournir du matériel végétal aux utilisateurs qui en font la demande. |