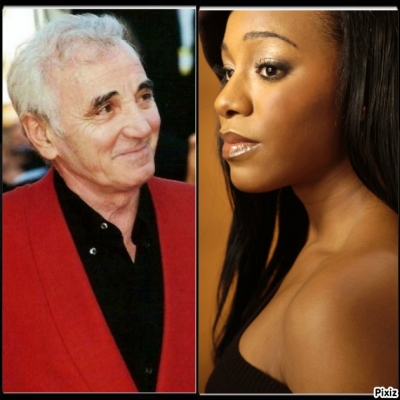La conférence de Rio + 20 en Juin 2012 leur a laissé un goût amer : difficulté à être entendus par les grandes puissances, et même à leur surprise, négligence de la part des grands émergents. Tous les états insulaires victimes des dérèglements climatiques ont donc décidé de se réunir sous la même bannière. « Nous émettons une parcelle infime de CO2, moins de 0,3% des émissions mondiales pour une surface qui avec son domaine maritime représente un quart du globe, et pourtant, nous connaissons les premiers réfugiés climatiques avec la montée des eaux dans certains archipels »
L’Océanie est également devenue un nouvel enjeu politique et géostratégique pour les grandes puissances économiques qui font de l’Océan leur terrain de jeu privilégié avec aujourd’hui la pêche industrielle, et demain, l’extraction des nodules.
Le premier sommet du développement durable océanien veut apporter des solutions concrètes. De la centrale électrique de l’île Ouen fonctionnant grâce à un mix énergétique solaire et huile de friture, à la culture du Jatropha ou à la remise en production de plantations de cocotiers au Vanuatu, de la «fabrication domestique» de gaz à Fidji, de l’aquaculture aux micro-algues, des terres rares à la gestion des déchets, l’Océanie est pleine de réponses locales déjà expérimentées qui pourraient être adaptées et généralisées plus largement aux îles et territoires du Pacifique. Mais dont l’exploitation incontrôlée peut être également source d’immenses déséquilibres.
Entre partenaires îliens, on parlera donc beaucoup de la mer.
D’autant que vient de se dérouler à Paris une première réunion internationale « La haute mer, avenir de l’humanité ». La France y a réaffirmé sa volonté de reprendre la main sur une décision prise à Nagoya et ratée à Rio : parvenir à une Convention mondiale qui gère la Haute mer, et prévoit la mise en protection de 10% des superficies.
Aujourd’hui, en droit international, la Haute Mer est définie comme des espaces maritimes qui ne sont placés sous l'autorité d'aucun État, sont au delà des zones côtières gérées par chaque pays. Aucune souveraineté, aucune priorité dans l’accès à la ressource, aucun exclusivisme. On en a conclu à un res nullus. « Cela aurait pu marcher dans un monde vertueux, mais c’est une erreur de perception. Entre tout le monde, et personne, il y a le bien commun » rappelle Elie Jarmache, du Secrétariat général à la mer. La Haute Mer est devenue le Far West, où flottent containers abandonnés, 7° continent de plastiques. Un territoire que l’on épuise avant de le connaître comme le souligne le Directeur du Muséum Gilles Bœuf. « Sur les 235 000 espèces vivantes connues, 13% seulement sont issues du milieu océanique. Nous avons beaucoup à découvrir sur ces groupes ancestraux qui ont plus de 600 Millions d’années et n’ont jamais su sortir de ce milieu extrême ». L’homme y prélève des trésors dont il ne mesure pas la rareté : « Quand on pêche un grenadier qui ne devient fécond qu’à 32 ans et n’a que trois ou quatre petits, ce n’est pas d’épuisement de stocks qu’il s’agit, mais d’atteinte à une merveille de la nature » .
Ce territoire marin couvre la moitié de la surface du globe et 64% des océans.
La négociation qui s’annonce va être d’une complexité extrême.
L’ambassadeur Jean-Pierre Thébaud a mis en garde : « ne soyez pas pressés, cela va mettre du temps ». Et pourtant, il faut progresser sur la gouvernance de la mer dont l’exploitation ne fait que commencer.
Continu, unique et relié, milieu dans lequel les actions sont cumulatives et transverses, l’Océan doit donner les clefs du futur. « Il ne s’agit plus seulement de découvrir et d’inventorier, mais de compter, d’évaluer, de faire des modèles de cette infinie complexité, de cet incroyable écosystème qui ne se fragmente jamais puisque l’océan est un milieu continu ». Eric karsenti, Directeur de Tara Océan a insisté sur ce fait. Il a demandé que les zones de reproduction soient très fortement contraintes jusqu’à l’ interdiction, comme celle de poursuivre l’exploitation du krill dans l’antarctique, ou de contrôler les zones de reproduction corallienne.
La meilleure connaissance enclenche forcément une approche collaborative.
Les aires marines seraient couvertes par un niveau allant de 1 à 6, le niveau 6 étant une zone sanctuarisée.
Les acteurs d’Oceania 21 l’ont compris, les discussions sont possibles, conduites en amont, elles peuvent respecter les intérêts des uns et des autres.
Ainsi, la Nouvelle Calédonie aimerait poursuivre la zone de protection mise en place par l’Australie sur la mer de corail par un corridor allant jusqu’au lagon, en niveau 2 de protection, c’est à dire interdisant toute activité de nature extractive, et une pêche industrielle limitée. Le projet a été présenté à Cook l’été dernier. La fondation PEW qui aide à la mise en place des plus grandes réserves marines mondiales ( + de 100.000 km2 : Kermalec, Hawaï, Ile de pâques, Bermudes, Iles Sandwich…) s’est saisie du dossier à la demande du gouvernement Calédonien, Jean-Paul Michel directeur de Pew France précisant « le gouvernement calédonien est le « patron » en matière d’environnement sur son territoire et veut copier le modèle australien avec une carte des vocations (la diversité des vocations correspondant à la diversité des activités). Nous avons bon espoir de parvenir à des consensus ».

La Polynésie a l’idée de reprendre l’exemple des Marquises et de placer le programme de protection / développement sous l’égide de l’Unesco et de son programme Nature et Culture, espérant devenir zone Patrimoine de l’Humanité en 2016. « Ils aimeraient constituer cette réserve pour les générations futures, voulant anticiper, car ils craignent l’invasion des pêcheries chinoises ». Cette question est un des enjeux principaux des élections polynésiennes en cours. Le Président sortant défend un gros contrat de pêche et d’aquaculture avec les chinois qui divise la société polynésienne. La réponse au second tour le 5 Août prochain…